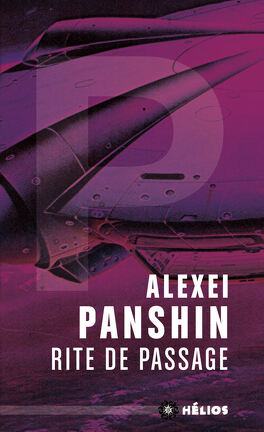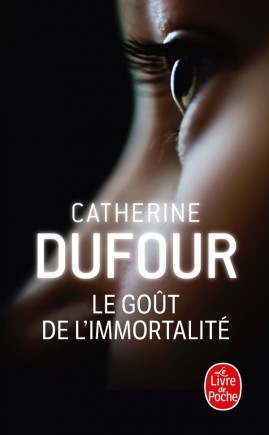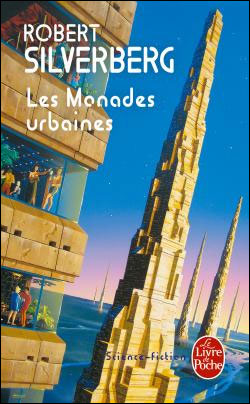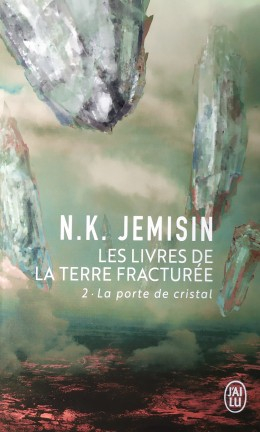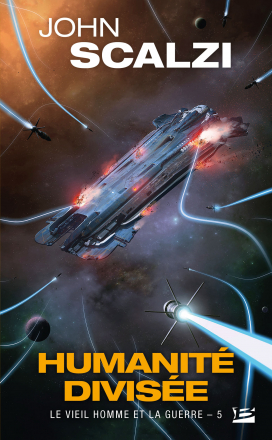Une superbe claque.

Afrique, après l’apocalypse.
Le monde a changé de bien des façons, mais la guerre continue d’ensanglanter la terre. Une femme survit à l’anéantissement de son village et au viol commis par un général ennemi avant de partir errer dans le désert dans l’espoir d’y mourir. Mais au lieu de cela, elle donne naissance à une petite fille dont la peau et les cheveux ont la couleur du sable. Persuadée que son enfant est différente, elle la nomme Onyesonwu, ce qui signifie, dans une langue ancienne : « Qui a peur de la mort ? ». À mesure qu’elle grandit, Onyesonwu comprend qu’elle porte les stigmates de sa brutale conception. Elle est « ewu » : une enfant du viol que la société considère comme un être qui deviendra violent à son tour, une bâtarde rejetée par les deux peuples.
Mais sa destinée mystique et sa nature rebelle la poussent à se lancer dans un voyage qui la forcera à affronter sa nature, la tradition, les mystères spirituels de sa culture, et à apprendre enfin pourquoi elle a reçu le nom qu’elle porte.
Qui a peur de la mort ? est un roman tout à fait exceptionnel. Le lecteur occidental est transporté dans un univers étrange et mystique, où règnent le désert, les chameaux sauvages, les esprits, les sorciers, un monde qui est aussi celui des enfants soldats, des viols de guerre, des massacres et des génocides ethniques. Un univers empli de prophéties, de résignation, de préjugés et de traditions, mais aussi de révoltes, de rebelles, de femmes et d’hommes (mais surtout de femmes) qui secouent le joug du passé et des oppressions millénaires.
L’aspect SF post-apocalyptique passe totalement au second plan, ce livre est beaucoup plus un récit mystique et, sous de faux airs de conte pour enfants, une évocation très crue et très cruelle qu’il faut réserver à un public adulte : excisions, viols, massacres, meurtres particulièrement sanglants, inceste, et on en passe. L’ensemble, s’il n’est pas particulièrement réjouissant, reste lisible grâce au parcours initiatique d’Onyesonwu, plongeant dans les dimensions fantastiques et magiques d’un univers fascinant. L’alchimie est parfaite, ne sombrant jamais dans de la mauvaise dark fantasy version africaine ni dans le trip politique sous LSD. Les incursions de et vers le monde magique sont toujours liées à la situation des personnages dans la guerre qui les oppose à un adversaire terrifiant.
C’est aussi un roman de femmes. Tous les héros sont des héroïnes, ou presque. Les hommes sont pour la plupart des boulets, des vieux cons ou des tortionnaires sadiques. À l’exception notable de la figure paternelle, mais qui plane comme une ombre protectrice et inspirante plutôt que comme un réel protagoniste de l’histoire, et de Mwita, le petit ami, compagnon d’arme, mais qui reste finalement assez effacé. Au contraire, toutes les protagonistes féminines vont chercher en permanence à échapper au poids des traditions, du contexte historique, des autorités morales et religieuses, des conventions sociales, pour trouver leur propre chemin de vie. Elles ne réussissent pas toujours, elles sont parfois (souvent) victimes d’une société qui toute entière veut les cantonner dans leurs rôles d’épouses et de mères, mais elles ne résignent jamais. Ainsi, à chaque fois qu’on pense qu’Onyesonwu est sur les rails d’une trajectoire définie par son destin, elle choisit de la refuser et de brouiller les pistes. Cela rend le récit imprévisible, surprenant, et très rafraîchissant.
Le seul bémol est un final un peu bâclé, un anti-climax où ce qui aurait dû être le point culminant de l’histoire se règle en quelques lignes, et un épilogue ouvert où l’auteure semble hésiter sur la couleur de la conclusion et termine par une pirouette. Mais c’est un tout petit bémol pour un roman magistral, brillant, déroutant et fascinant. La plupart des personnages prennent vie au fil des pages, et certaines passages resteront gravés longtemps dans la mémoire du lecteur.
Quia peur de la mort ? a reçu le World fantasy Award du meilleur roman en 2011. Nnedi Okorafor a annoncé en 2017 une adaptation en série par HBO, avec George R. R. Martin dans le rôle de producteur exécutif.
Nnedi Okorafor : Qui a peur de la mort ? – 2010
Originalité : 5/5. Difficile de trouver quelque chose qui ressemble à ce livre.
Lisibilité : 4/5. Quelques longueurs, un final qui se traîne un peu puis se conclut très (trop) rapidement, de manière expéditive. En dehors de ces petites réserves, quel plaisir de lecture !
Diversité : 5/5. Le nombre de thèmes traités dans ce livre, des dimensions éloignées qui s’entrechoquent et s’entremêlent sans jamais perdre une alchimie si fragile, c’est un tour de force.
Modernité : 4/5. La guerre, le génocide, la condition des femmes, les enfants soldats, les conflits ethniques, le racisme, la tradition, les préjugés, le tout traité dans un roman fantastique qui ne ressemble jamais à un pamphlet, c’est un autre tour de force.
Cohérence : 3/5. Dommage pour l’épilogue, mais l’ensemble tient remarquablement la route.
Moyenne : 8.2/10.
A conseiller si vous n’avez pas peur d’un récit parfois très dur, mais magnifique.