Ça décolle quand, cette histoire ?
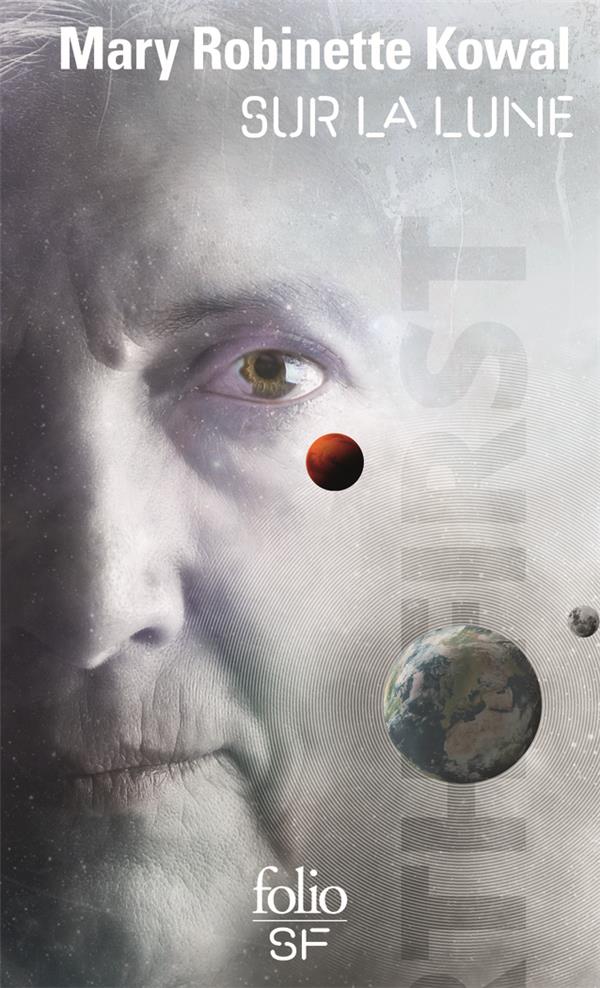
Sur Terre, la situation est critique : le climat se détériore inexorablement et les tensions politiques s’accroissent. Une coalition internationale espère envoyer le plus de gens possible sur Mars avant que la planète bleue ne devienne inhabitable, mais il est évident que tout le monde ne pourra pas partir. Les manifestations contre le projet de conquête spatiale virent à l’émeute et des tentatives de sabotage des fusées sont mises au jour. Le FBI craint désormais un attentat de grande ampleur visant la colonie lunaire, première étape vers Mars, ce qui condamnerait définitivement le programme spatial. Nicole Wargin, l’une des premières femmes astronautes, amie d’Elma York, se voit confier une mission en urgence pour le déjouer sur place. Malheureusement, le moment est plutôt mal choisi pour quitter la Terre : son mari, gouverneur du Kansas, envisage de se lancer dans la course à la nouvelle Maison-Blanche. Alors qu’Elma est à mi-chemin de Mars, si Nicole échoue, la survie de l’humanité pourrait être compromise.
Troisième tome de la série Lady Astronaute, Sur la Lune se déroule en parallèle au tome 2, Vers Mars, et il est clairement le meilleur du cycle à ce jour, en grande partie parce qu’il suit Nicole Wargin, une des protagonistes des précédents romans.
La première partie de l’histoire se déroule au Kansas, où on peut enfin vivre les différents développements liés aux tensions sociales, politiques et raciales exacerbées par la chute du météore (voir Vers les étoiles), comblant ainsi un des manquements les plus flagrants des tomes précédents. Bien sûr, il ne faut pas être trop exigeant, l’approche de Kowal n’a pas changé, tous les bouleversements de la société ne sont vus que par le prisme des relations de couple des protagonistes principaux, dans ce cas-ci Nicole et son mari Kenneth, gouverneur du Kansas et candidat aux élections présidentielles.
De la même manière, Nicole Wargin est un personnage beaucoup plus intéressant et attachant qu’Elma York, l’héroïne des deux premiers tomes. Nicole est plus forte, plus subtile, plus maligne, et donc subit beaucoup moins les événements qu’Elma. Mais Kowal juge nécessaire de lui infliger une profonde et douloureuse anorexie, comme si toutes ses héroïnes devaient absolument développer des troubles psychopathologiques importants, comme une forme d’intériorisation des difficultés rencontrées par les femmes dans les sociétés occidentales de l’après-guerre. Ça n’était pas nécessaire du tout, ça n’apporte rien ni au récit ni au personnage, en plus de nous repasser les plats qui ont déjà servis pour Elma York.
La deuxième partie, la plus importante, se déroule dans la base lunaire, où on va vivre une espèce de thriller d’espionnage dans lequel les héros tentent de démasquer un saboteur. Ça n’est pas totalement déplaisant, même si on pourra regretter les incohérences et le manque de réalisme, les ellipses, les énormes trous dans l’intrigue, des situations et des personnages un peu trop caricaturaux, et un dénouement un peu facile. On s’ennuie, certes, mais moins que dans Vers Mars, c’est déjà ça.
Nominé pour le prix Hugo du meilleur roman en 2021, Sur la Lune brille surtout pour sa rigueur technique, Kowal ayant la bonne idée de s’entourer de véritables spécialistes pour tous les aspects scientifiques et technologiques de ses romans. Cela lui permet de créer un environnement parfois fascinant et toujours dépaysant. Dommage qu’il soit aussi vide d’émotions et de sense of wonder.
Mary Robinette Kowal : Sur la Lune – 2020
Originalité : 2/5. Un léger mieux par rapport à ses prédécesseurs.
Lisibilité : 3/5. Sans relief mais sans difficulté.
Diversité : 3/5. Le récit aborde enfin différents thèmes, même si ça reste très superficiel.
Modernité : 3/5. Pas impossible que certains chapitres trouvent bientôt une actualité plus visible.
Cohérence : 2/5. Des méchants insaisissables et des gentils fort peu réactifs pendant la plus grande partie du roman, avant que ça s’inverse totalement pour clôturer le récit. Les ficelles sont grosses.
Moyenne : 5.2/10.
A conseiller si vous avez apprécié les deux premiers tomes, évidemment.









